
Alors que le bouclier sanitaire chinois se fissure dans une vingtaine de provinces sous les assauts du variant Delta (plus de 1000 cas au 10 novembre), la Chine dégaine sa dernière arme de traçage : le « compagnon spatio-temporel » (时空伴随者”: shí kòng bànsuí zhě).
Derrière ce nom intriguant, ayant suscité plus de 3 millions de recherches sur Baidu en quelques jours, un système dérivé de la fameuse « flèche verte » obtenue à partir des données mobiles de son téléphone. Ce traçage 2.0 consiste à repérer tous ceux dont le smartphone a été détecté à moins de 800 mètres de celui d’un cas confirmé de Covid-19, pendant plus de 10 minutes, durant les 14 derniers jours. Les personnes concernées reçoivent alors un SMS pour les prier de se signaler auprès des autorités et de rester chez eux le temps de réaliser trois tests PCR en 72 heures. Naturellement, toutes ces personnes perdent leur code QR de santé « vert », nécessaire pour pénétrer dans les lieux publics et voyager à travers le pays.
Cette méthode, initialement employée à Chengdu (Sichuan), a permis de retracer au moins 82 000 potentiels « cas contacts » en analysant les données mobiles de ses 20 millions d’habitants. Elle a également été adaptée dans d’autres villes : Changsha (Hunan), Shijiazhuang (Hebei), Xi’an (Shaanxi) ou encore Pékin.
En théorie, ce système pourrait permettre d’éviter de coûteuses et massives campagnes de dépistage à grande échelle. Sauf qu’en pratique, les autorités y ont toujours recours. C’est ce qui pousse certains internautes à qualifier ce système de « sur-prévention », voire de « pratique illégale » puisque les données personnelles sont utilisées sans le consentement des utilisateurs (au lendemain même de l’entrée en vigueur d’une loi à ce sujet). D’autres s’insurgent contre la stigmatisation sociale qui en découle, sachant que depuis le début de la pandémie, toutes les personnes ayant contracté le virus (puis l’ayant transmis à d’autres) sont pourchassées sur internet et souvent mises au ban de la société.
Face à cette politique stricte, les cas de fraudes se multiplient : certains tentent de s’enfuir pour échapper au dépistage et surtout à l’éventuel confinement, d’autres montrent de faux tests PCR ou code QR de santé… Indéniablement, une certaine « fatigue pandémique » se fait sentir, en Chine comme ailleurs.
Cependant, la population ne va pas jusqu’à remettre en cause la stratégie « zéro cas » qui les a protégés du virus jusqu’à présent. Cette perception est accentuée par les médias officiels qui relatent constamment les ravages de la Covid-19 à travers le monde, aux États-Unis surtout.
En parallèle, les habitants savent mieux que personne que le système de santé chinois, souffrant de disparités criantes, ne saurait faire face à une déferlante de cas nécessitant une hospitalisation. Les scènes de panique dans les hôpitaux de Wuhan saturés, en janvier 2020, l’ont démontré…
Plusieurs experts chinois questionnent néanmoins la pertinence de cette stratégie « zéro cas », alors que la plupart des pays asiatiques ont décidé d’assouplir leur approche sanitaire. Après l’expert shanghaien Zhang Wenhong qui avait « osé » avancer l’idée de « coexister avec le virus » (avant de voir sa réputation personnelle attaquée), c’est au tour du virologue Guan Yi – qui avait prédit en janvier 2020 que l’épidémie de Wuhan serait 10 fois pire que celles du SRAS – d’écorner cette politique « néfaste pour l’économie » lors d’une interview avec Phoenix TV diffusée le 8 novembre (jour d’ouverture du 6ème Plenum).
Alors que le Parti a officiellement décrété avoir « remporté la guerre contre le virus » dès septembre 2020, le spécialiste de l’université de Hong Kong a affirmé que « nous ne devrions pas déclarer victoire trop vite », le virus étant aujourd’hui « totalement adapté aux humains » (ce qui n’était pas le cas du SRAS en 2004). Dans ces conditions, « cette stratégie est trop coûteuse et l’objectif ‘zéro cas’ ne sera jamais atteint », a-t-il déclaré. C’est exactement l’inverse des déclarations formulées quelques jours plus tôt par l’expert de référence auprès du gouvernement, Zhong Nanshan, qui a défendu cette stratégie, « moins coûteuse » que de soigner les personnes infectées.
Toujours selon Guan Yi, au lieu de s’acharner à tester pour détecter le virus, la Chine devrait avoir « le courage » de conduire une large campagne de tests pour évaluer le niveau d’anticorps et leur durée dans le temps afin de véritablement connaitre l’efficacité des vaccins chinois. Au passage, le virologue n’a pas manqué de dénoncer « les groupes d’intérêt » et « les profiteurs malhonnêtes » qui tirent bénéfice de cette campagne massive d’inoculation (plus de 2 milliards de doses injectées)…
Même si ces propos sont pleins de bon sens et courageux, tant que le virus présentera un risque de contagion qui pourrait mettre à mal le système national de santé, tant que les vaccins chinois n’offriront pas une « barrière immunitaire » suffisante ou qu’un traitement efficace n’aura pas été trouvé, Pékin ne bougera pas d’un pouce.


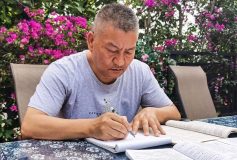


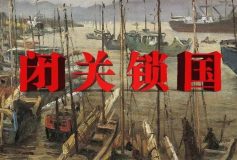

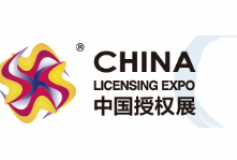










Sommaire N° 37 (2021)