
Zhang Xiufang eut une enfance originale, au Henan. L’absence de père l’avait mariée à la précarité, la privant de dîner plus souvent qu’à son tour. En revanche, mère et fille vécurent ces années ’80 en liberté totale, tissées de fou-rires, rêves et imagination débridée. Elle fut aussi enfant de la balle, élève gratuite des maîtres de qigong ou taichi dans les parcs. Travaillant des heures par jour son sabre, bâton ou diabolo, elle gagna bientôt sa pitance en show de rue et autres métiers de fortune, telle la vente à la sauvette de kong zhu, bambous-accessoires obligés des acrobates.
A 22 ans, cette fille idéaliste et désintéressée épousait un homme de son style : spirituel, agréable et franc, mais totalement inadapté aux réalités de la vie. Malade chronique, chômeur toujours, il ne fournissait pas un 份 (sou) au budget commun. Autant dire que 16 ans après, le couple, avec leur fille lycéenne, n’avait pas toutes ses aises.
En 25 ans de spectacle, Xiufang s’était frottée à tous les genres : martial (en tenue de choc, à Tianjin), bouddhiste (en une sirupeuse corolle de lotus à Shanghai), opéra (en masques, à Zhuhai), sportif (en survêt’, aux fêtes des JO de Pékin). Mais elle se contorsionnait en vain, juste pour quelques bravos, de rares piécettes. Des saltimbanques de son genre, la Chine en avait « à la pelle » : pas moyen de faire la différence.
En mars 2010, elle craqua. Se priver de tout, pour elle-seule, c’était OK, mais devoir refuser à sa fille la flûte dont elle rêvait depuis des années, c’était un cauchemar. Aussi, pour un salaire ridicule mais garanti, à l’agence n°4 d’hygiène environnementale de Chaoyang, elle rejoignit une escouade de balayeuses aux casquettes de base-ball et vareuses fluo— celles que les mamans montraient aux petites filles en chuchotant : « voilà où tu vas finir, si tu n’étudies pas » !
L’artiste en elle, cependant, se rebellait contre la porte fermée à son talent. Elle avait du mal à faire causette avec les collègues, qui la trouvaient bêcheuse. Mais elles cessaient de lui en vouloir dès qu’elle lançait son balai en l’air pour le rattraper sur l’échine, le bras, les mollets, le cou, marchant sur les mains, jambes en « V » vers le ciel, face aux passants ébahis : par le plus grand des hasards, Zhang venait de découvrir la mise en scène appropriée, mi-dérisoire mi-admirable, pour un show d’une ère nouvelle, post-prolétaire.
Il ne fallut qu’un mois pour qu’elle reçoive un appel, l’invitant à l’émission Nouvelle star chinoise, sur TV-Sichuan. On l’avait filmée sur téléphone portable, puis posté la vidéo sur Internet : le clip avait reçu 30 000 clics en 3 jours.
Sa réponse fut d’abord non. Zhang croyait -encore- que ce déguisement était une trahison à son art, et à l’ordre social. Et puis s’envoler trois jours pour Chengdu, à peine embauchée, était impensable.
Le cachet (8 000¥), le coup de fil du réalisateur à sa chef, balayèrent les résistances. L’émission fut un succès triomphal, lui valant la célébrité immédiate sous le sobriquet de «soeurette du balai» (扫帚姐, sàozhou jiě).
Les faits s’enchaînèrent. La seconde invitation tomba : Boulevard des étoiles, l’émission nationale de Pékin—rien que ça ! Après des jours à méditer ses options—c’était le tournant de sa vie, et elle le savait—elle réclama un congé, qui fut refusé. Elle s’y attendait et passa outre, déclenchant ainsi sa mise à pied. Laquelle fit fuser les émotions dans les chaumières : c’était « leur » héroïne qu’on assassinait ! Même des cadres, ayant vu le nouveau phénomène, parlèrent en sa faveur en haut lieu. Une star était née.
Si son souci de carrière est maintenant réglé, celui existentiel demeure. Xiufang, au temps de chiens, évitait de causer aux nettoyeuses, se disant « artiste ». Mais aujourd’hui, elle se retrouve toute gauche face aux célébrités du show-biz venus saluer la nouvelle venue : «on n’est pas du même monde, prétend-elle, moi, c’est balayeuse» – ce qui une fois de plus, pourrait passer pour de l’orgueil.
Mais on la comprend. Zhang a du mal à jeter aux orties ses oripeaux d’hier, d’artiste ratée et « souillon » des hutongs. Quand on part de si bas pour monter si haut, on ne peut pas le faire trop vite. Il faut des paliers, pour éviter l’asphyxie, pour laisser à son être le temps de s’adapter. Pour accepter sa bonne fortune, ce qui en Chine se dit: « s’abandonner au destin» (委诸命运, wěi zhū mìngyùn ).
Cet article a été publié pour la première fois le 26 septembre 2011 dans le Vent de la Chine – Numéro 31 (2011)


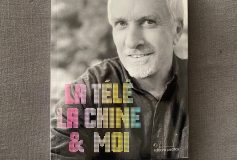



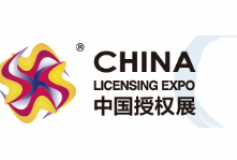











Sommaire N° 1 (2023)