A Dalian (Liaoning), les patrons de Fujia Chemical soupiraient de soulagement le 8/08/2011 : l’orage tropical Muifa n’avait détruit qu’une digue, pas leur usine. Mais le 14, ils apprenaient la décision de fermer le site: fruit d’une manif de toute une métropole muée en activiste-écolo !
En fait, tout était joué avant l’orage, par ce qu’il faut bien appeler une bêtise de ce groupe semi-privé (1,5 milliard de $ d’investissement). En reportage sur les risques pour l’usine de cette tempête qui s’approchait, une équipe de TV s’était fait rosser aux portes de Fujia, qui avait aussi fait interdire l’émission. Fujia avait le bras long: co-propriétaire, la mairie touchait aussi 330M$ de taxes/an, sur les 700.000t de paraxylène (PX) produites sur le site, un composant du polyester. Or à Xiamen en 2007, une mobilisation populaire avait déjà fait échec à un projet similaire d’usine de PX.
En Occident, l’affaire aurait été gérée par la presse, permettant à l’opinion de mieux mesurer les risques. Car selon un militant de Greenpeace-Chine, la toxicité du PX n’aboutirait à guère plus que de simples irritations (yeux et peau). Mais quand la digue se brisa, la population au courant de la censure télé, imagina le pire : des profusions de naissances anormales, des morts en 8 minutes au contact de l’eau de mer… Bientôt, la ville bouillait, exigeant le départ immédiat de Fujia -question « de vie ou de mort ».
S’ensuivit un curieux bras de fer. Sur les forums internet, la censure s’activait. Mais sur Sina Weibo ou Renren, ces services de mini-blog et de rencontre sociale, on se donna Rendez-vous pour le dimanche suivant, sans que puisse être identifiée une source précise. A l’heure dite, malgré la présence de nombreux policiers, ils étaient 12.000 à crier «Fujia dehors», ou «rendez-nous Dalian». Certains arboraient même, typique d’un activisme «à la chinoise», un T-shirt imprimé par leur entreprise, soutenant la manif.
Dès 10h30, Tang Jun, le Secrétaire du Parti, montait sur une voiture, mégaphone en main, promettant la fermeture et le départ demandés. Faute d’entendre une date limite d’exécution de la promesse, les activistes maintinrent l’occupation jusqu’à l’après-midi, où le maire Li Wancai réitéra la promesse. Suite à quoi la foule se dispersa – apparemment sans être inquiétée.
En Chine, ce succès d’une foule sur une autorité est rare. A pu jouer la crainte d’un scénario-horreur remonté de la mer, style Fukushima. Probablement aussi, le renouvellement en cours de tout l’appareil d’ici oct. 2012. Pour les apparatchiks, c’est le moment de prouver leur capacité à gérer les crises et leurs vertus populistes. Toutes proportions gardées, cette atmosphère «pré-électorale» peut susciter chez les leaders une forme d’écoute plus permissive.
Sans nul doute, c’est de la rue que vient le changement : là, triomphe le syndrome nimby (de l’américain«not in my backyard »), le refus d’infrastructures d’intérêt public près de chez soi. En Chine, de source officieuse, les troubles sociaux sur fond de dégradation de l’environnement dépassent les 100.000 par an. A Dalian, cette sensibilité peut émerger plus vite qu’ailleurs, du fait de sa fonction (ballon industriel) et de sa géographie (à la pointe d’une péninsule, au coeur de la mer de Bohai). Du fait aussi d’incidents pétrochimiques à répétition (pollution de la Songhua en 2005, de la mer de Bohai depuis juin, cf. ci-dessous).
Ajoutons l’accès à la propriété d’une bourgeoisie émergente, prête à défendre son bien autant que sa santé, et le lancement depuis deux ans de Weibo, le «twitter» chinois aux 200 millions d’usagers de moins en moins contrôlables. Tous les ingrédients sont là pour permettre à un « lobby de rue » d’exercer un début de pression apolitique, non idéologique, impensable il y a seulement cinq ans !





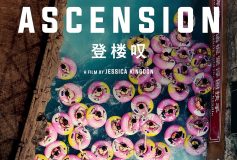

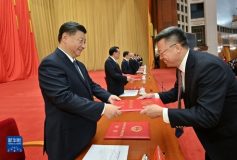










Sommaire N° 27